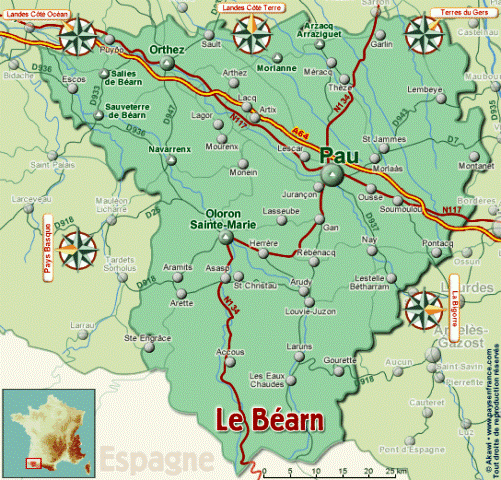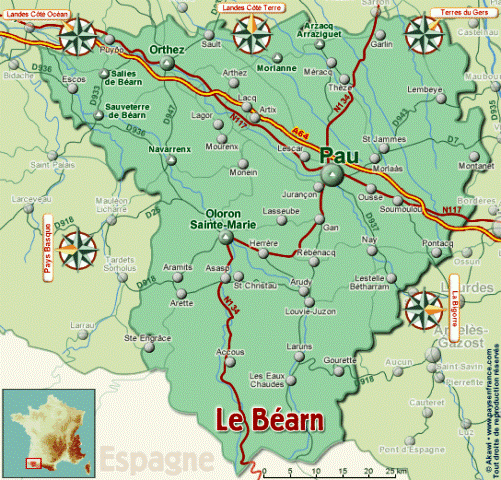
Le Bearn

André Gabastou

Pisón, Vargas Llosa y Atxaga

V-M, Gabastou y Lago

Gabastou y Paula, París 2012

Dedicatoria de Atxaga a V-M
|
UN TRADUCTEUR SOUS INFLUENCE.
ANDRÉ GABASTOU
« J’ai lu tel livre ; et après l’avoir lu je l’ai fermé ; je l’ai remis sur ce rayon de ma bibliothèque, — mais dans ce livre il y avait telle parole que je ne peux pas oublier. Elle est descendue en moi si avant, que je ne la distingue plus de moi-même. Désormais je ne suis plus comme si je ne l’avais pas connue ».
André Gide. De l’influence en littérature.
Enfant, je ne suis jamais allé ni à Bordeaux ni à Paris, nos capitales, la première de l’Aquitaine, la seconde de la France. En Italie et en Amérique non plus. Pour mon village béarnais, à quelques jets de pierre du Pays basque, l’Adour dessinait une barrière que peu franchissaient. Un sénateur de l’époque se vantait de ne jamais tirer le rideau de son train entre Pau et Paris. Une manière de signifier que nous venions d’ailleurs, peut-être de l’ancien royaume de Navarre malgré son rattachement bien lointain à la France. Dans la grande maison familiale, les étrangers venaient du Nord (tel ou tel membre de la parentèle) ou du Sud (des missionnaires noirs dont je n’ai jamais su la raison profonde de leur présence). On y parlait français, occitan, mais jamais basque, pourtant la langue de nos premiers voisins (lehen auzoa). Né dans un catholicisme réactionnaire sans agressivité, mon père était devenu au fil des années progressiste. Il avait fait preuve de courage du temps du camp de Gurs qui avait accueilli d’abord des républicains espagnols, puis des juifs mais, maire du village, il avait oublié de poser sur sa hampe le drapeau français à la Libération, ce qui lui avait valu quelques ennuis. Malgré quelques contradictions qui devaient sans doute le faire souffrir, il ne transigeait pas sur le chapitre de l’éducation. Les enfants qu’il destinait aux études devaient apprendre des langues qui, à ses yeux, étaient comme on le pensait souvent à l’époque un facteur de paix. Aussi avait-il conclu une sorte de pacte avec un Basque des environs de Bilbao (Las Arenas) : ces mêmes enfants apprendraient l’espagnol chez lui pendant que ceux de son ami basque s’initieraient au français en Béarn. Un seul par séjour. C’est ainsi que, très jeune, j’ai été amené à franchir la frontière espagnole en train, via Bilbao. Je me souviens d’un voyage interminable dans des tortillards cahotants, des longues attentes à Hendaye (l’écartement différent des rails en France et en Espagne compliquait le trajet), de collines vertes de près et bleues de loin (Bernardo Atxaga), d’une grande ville noire, de hauts fourneaux, du pont suspendu de Biscaye traversant l’estuaire du Nervión, des villas cossues d’Algorta, des plages de l’Atlantique, des premières surprises-parties dans la grande ville et des premiers béguins romancés faute de pouvoir leur donner la moindre assise matérielle. Ce fut mon Grand Tour.
Mais je ne me souviens pas du tout de mon apprentissage de la langue espagnole qui a dû se faire, comme souvent chez les enfants, sans heurts. Je n’ai jamais entendu prononcer un seul mot en basque, l’usage de cette langue étant violemment réprimé sous Franco. L’ami de mon père était étrange, il fréquentait assidûment les églises, nous obligeait à prier avant les repas et dans la voiture pour conjurer les accidents mais il ne faisait jamais la moindre allusion au caudillo. J’ai su plus tard pourquoi : il était carliste, comme beaucoup de Basques qui crurent que don Carlos, s’il accédait un jour au pouvoir, défendrait leurs fueros, autrement dit leurs privilèges territoriaux. J’ai exploré un Pays basque industriel, urbain, affairé, mais je connaissais l’autre, le Pays basque des petites collines, des petits ruisseaux, des petits champs, la Soule, de laquelle ma famille était descendue dans la vallée du gave d’Oloron pour survivre.
C’est en apparence par hasard que j’ai traduit mon premier livre de l’espagnol en français. Une parodie de roman policier (murder party) écrite par l’écrivain argentin Adolfo Bioy Casares, l’ami de Borges, et sa femme Silvina Ocampo : Ceux qui aiment haïssent. J’avais trouvé le roman si plaisant que j’avais proposé à Christian Bourgois, un éditeur mythique, de le traduire et il avait immédiatement accédé à ma demande. Bioy Casares était comme Jules Supervielle originaire d’Oloron-Sainte-Marie, ce qui d’une certaine manière me maintenait dans la grande confrérie béarnaise (plus fantasmée que réelle). Adolfo Bioy Casares, que j’ai bien connu, avait tous les charmes de la culture quand elle fait bon ménage avec l’argent : beauté, grâce, élégance, retenue. Charmes un peu écornés par une certaine indifférence à autrui et une légère superficialité dans les échanges (à la fois démentie par son œuvre dont la construction est si sophistiquée et confirmée par une réticence à plonger dans les abîmes de l’âme).
Ma première traduction m’avait fait renouer des liens avec mon pays natal quitté depuis longtemps, le Béarn. Si Bioy Casares en parlait souvent, il n’y fit que rarement allusion dans son œuvre. Je retrouvais une vieille routine ; dans ma jeunesse, je lisais tout ce qui s’écrivait sur cette pente sans grandes aspérités des Pyrénées : Francis Jammes, Paul-Jean Toulet, Pío Baroja, Unamuno, les voyageurs, romantiques ou pas. Comme je l’avais quittée, je n’en avais plus qu’une connaissance livresque.
Mais c’est par la découverte de l’écrivain basque d’expression euskerienne, Bernardo Atxaga, originaire d’Asteasu, près de Tolosa, que ces petites touches impressionnistes sont devenues un large coup de pinceau : ses textes ont donné une sorte de cohérence à mes premières impressions. Je l’avais écouté attentivement, lors d’un salon du livre de Bordeaux, pressentant une nouveauté absolue dans une littérature marquée par la répétition des formes et les considérations idéologiques (rurales et religieuses). À la faveur de fêtes de fin d’année, je suis allé le voir à Andoin où habitaient ses parents et j’ai eu l’audace, en principe inconcevable chez moi, de sonner à sa porte. Il a ouvert une fenêtre et m’a regardé d’un air effrayé parce que, comme je l’ai appris plus tard, avec mon bonnet enfoncé jusqu’aux sourcils à cause de la bruine et du froid, il m’avait pris pour un militant de l’E.T.A (ce qui m’arrivait, hélas, régulièrement à la frontière à cause d’un héritage physique difficile à dissimuler). Le malentendu dissipé, il m’a remis un exemplaire de la version espagnole d’Obabakoak que j’ai lu d’une traite et dont, un matin, j’ai dit tout le bien que j’en pensais à l’éditeur Christian Bourgois qui a acheté les droits du livre dans l’après-midi même. Puis je l’ai traduit et il a reçu un excellent accueil critique dans la presse française qui y a vu l’acte de naissance de la littérature basque. Une erreur : cette littérature existait depuis longtemps, mais pas sous cette forme. Les ouvrages de Bernardo Atxaga évoquent presque toujours un monde révolu : une société rurale qui ne connaît pas encore les ravages de l’industrialisation peuplée d’êtres solitaires, en marge, rêvant pour compenser leurs frustrations. Un monde d’en bas, une humanité délaissée, à contre-courant. Mais la souffrance ne distord jamais la phrase, elle l’étreint, puis s’envole. Cette langue met des images derrière des mots comme trikiti, etxe, erle, heriotz, secoue des souvenirs qui les font revivre, les réinvente en nous réconciliant avec un passé enfoui dont la résurrection est aussi douce qu’une chanson de Mikel Laboa.
Bernardo Atxaga, qui avait vécu quelque temps à Barcelone, me parlait souvent de ses amis avec qui il avait partagé des illusions de jeunesse : Ignacio Martínez de Pisón, auteur d’un splendide roman, Dents de lait, et Enrique Vila-Matas, aujourd’hui mondialement connu mais lu avant tout par des lecteurs amateurs de littérature solipsiste, c’est-à-dire qui n’existe qu’en regard d’elle-même (la voie ouverte par Borges). Bernardo Atxaga avait réussi à me faire partager la perplexité que ce dernier suscitait en lui : un goût de l’excès et de l’excentricité plutôt rare dans le monde catalan. Je l’ai traduit sans chercher à le connaître. Mais tout a changé dès le jour où je l’ai enfin rencontré lors de journées consacrées à la traduction à Tarazona, où nous avions été invités. Le premier soir fut fidèle à la tradition, mais par la suite, je me suis tellement rapproché de lui que nous avons fini par écrire un livre d’entretiens : Enrique Vila-Matas, pile et face / Rencontre avec André Gabastou (Argol, Paris, 2010) qui m’a tiré vers une autre marge de l’Espagne (mais aussi un centre, contrairement au Pays basque) : la Catalogne.
Peut-être dois-je mon goût des écarts à un apprentissage assez peu orthodoxe de la langue espagnole : celle que l’on parlait dans mon enfance et mon adolescence à Bilbao, l’espagnol écorché du Pays basque, dont, au XVIIe siècle se moquait la comedia pour faire rire Madrid. Un hasard dont je ne me sens ni fier ni honteux mais qui me fait souscrire à ce que disait Pío Baroja à qui l’on reprochait son indifférence au casticismo (entre autres significations, la pureté de la langue) dans Mes paradoxes et moi : « Il existe dans les langues une tendance au moule ancien. Ainsi, l’Espagnol tend à être castillaniste. Pourquoi moi, qui suis basque, qui n’entends pas parler le castillan suivant les tournures d’Avila ou de Tolède, dois-je les employer ? Pourquoi dois-je cesser d’être basque pour être castillan si je ne le suis pas ? Ce n’est pas que j’aie un orgueil castillan, non, c’est parce que chacun doit être ce qu’il est, et, s’il peut être content avec ce qu’il est, tant mieux. |