| ENRIQUE VILA-MATAS | LA VIDA DE LOS OTROS | ||||||||||
|
|||||||||||
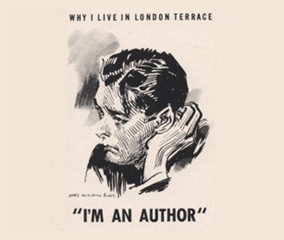 RAZONES PARA ENVIDIAR A VILA-MATAS NUEVAS TENDENCIAS EN LA LITERATURA ITALIANA CONTEMPORÁNEA |
TRADUIRE UN TRADUCTEUR DE FICTION ANDRÉ GABASTOU Il n’y a pas de littérature sans théorie de la littérature et il n’y pas de traduction sans théorie de la traduction. L’inverse est aussi vrai. Moyennant quoi la traduction de la langue induit une réflexion sur la langue de la traduction. Il manque encore dans le corpus français une anthologie à usage courant (disons pour les étudiants et le public lettré) sur les grands textes de réflexion sur la traduction (elle existe en Espagne) et on ne peut que le déplorer. Sans avoir à recourir à tel volume isolé de Benjamin, de Berman ou d’Eco, on s’apercevrait qu’il y a une histoire autonome de la traduction parallèle à celle de la littérature mais ne se confondant pas avec elle. Si elle suit grosso modo l’évolution des formes et des sensibilités culturelles, elle peut aussi les devancer, il suffit de penser à l’influence de la littérature américaine sur la française qui procède de la traduction, par exemple sur L’Étranger d’Albert Camus. À partir des années soixante-dix et grâce à l’essor des sciences humaines, la réflexion sur la traduction s’étend dans les universités au point de former assez vite une énième science du langage : la traductologie. Elle prospère aujourd’hui avec la globalisation du marché du livre, l’accès à l’université de couches sociales qui en étaient jadis exclues et, à notre échelle, la formation de l’Europe. Deux phénomènes en découlent : la reconnaissance de la traductologie et la création d’unités de formation de traducteurs à l’université ou à Bruxelles (Centre européen de traduction littéraire) qui imposent à la suite d’une haute lutte l’idée que la traduction n’est pas forcément superflue (qui est capable de lire en langage cree ?) et qu’elle n’est pas un don inné contrairement à une certaine conception romantique (métaphysique) de la langue et de l’auteur. Les traductologues, à quelques exceptions près (Eco qui a traduit Nerval et les Exercices de style de Queneau, Berman qui a traduit le romancier argentin Roberto Arlt), ne connaissent en général pas la pratique de la traduction, mais ils n’en sont pas pour autant illégitimes. Que le traductologue n’apporte rien au praticien de la traduction ne signifie pas qu’il est inutile ; au contraire, en « serrant » au plus près l’acte de traduire, il précise un paysage mental, induit des lignes de force, interdit des dérives. On ne traduit plus au vingt et unième siècle comme on traduisait au début du siècle dernier. La traduction impressionniste (telle aristocrate française supprimant un personnage d’un roman russe parce qu’elle le trouvait antipathique, tel tâcheron des années cinquante supprimant un personnage d’une nouvelle fantastique de Ray Bradbury pour faire court selon le souhait de l’éditeur) a pratiquement disparu du champ éditorial. La traduction y a gagné en précision et en éthique à telle enseigne qu’il existe aujourd’hui un pacte explicite (Code des Usages) entre traducteurs et éditeurs et implicite entre auteurs, éditeurs et traducteurs (longuement évoqué par Umberto Eco dans Dire presque la même chose — Expériences de traduction). Ce pacte repose sur un principe auquel on ne saurait déroger : le texte traduit doit être fidèle à l’original. Umberto Eco écrit dans Dire presque la même chose : « … le concept de fidélité participe de la conviction que la traduction est une des formes de l’interprétation et qu’elle doit toujours viser, fût-ce en partant de la sensibilité et de la culture du lecteur, à retrouver je ne dis pas l’intention de l’auteur mais l’intention du texte, ce que le texte dit ou suggère en rapport avec la langue dans laquelle il est exprimé et au contexte culturel où il est né ». C’est évidemment le « concept de fidélité » qui est à l’origine de toutes les théories de la traduction. La question clé est : que faut-il entendre par « fidélité » quand on sait, au moins depuis Jakobson, qu’il n’y a pas d’équivalence linguistique ? S’il y avait équivalence linguistique, il n’y aurait pas de traductions et le problème ne se poserait pas. Mais je ne dirai jamais tout à fait dans la langue B ce qui est dit dans la langue A. C’est dans cette impossibilité que se loge la traduction dans une position paradoxale : elle n’est pas divine, mais elle prétend dire la langue de Dieu. La langue parfaite n’existant pas, la traduction comme l’a fort bien montré Umberto Eco se situe dans cette figure de rhétorique très humaine qu’est la métaphore. La métaphore présuppose un lien entre les termes comparés et, si elle substitue l’un à l’autre, elle ne le fait pas par hasard. Bachelard a souvent parlé de métaphores vraies et de métaphores usurpées. Ce qui veut dire que si le texte B ne dit pas la même chose que le texte A, il n’empêche que le problème de la vérité se pose tout de même. La métaphore peut-être soupesée et faire l’objet d’un jugement. Le traducteur doit rester dans un possible linguistique et culturel induit par le texte A. En outrepasse-t-il les limites ou se maintient-il dans ce « presque » où il est écartelé entre deux langues ? Les polémiques sur la pratique de la traduction sont innombrables et infinies mais le problème fondamental ne varie jamais : où se placer entre la langue de départ et celle d’arrivée ? La réponse est donnée par l’art au cas par cas. On ne traduit pas de la même manière Adolfo Bioy Casares, écrivain d’origine française, qui écrivait comme les Français (disons comme Benjamin Constant, pour faire simple) ou Victoria Ocampo qui a appris le français avant l’espagnol et García Lorca dont les poèmes sont truffés de tournures et d’images andalouses (folkloriques disait cruellement Borges). Une œuvre de fiction, qu’elle soit de Bioy Casares ou de Lezama Lima, suppose un espace, un temps, une situation, des personnages, une langue. On peut raffiner. Dans Paris ne finit jamais, l’écrivain espagnol Enrique Vila-Matas en mal d’inspiration demande à Marguerite Duras des conseils et elle lui tend la feuille suivante : « 1. Problèmes de structure. 2. Unité et harmonie. 3. Thème et histoire. 4. Le facteur temps. 5. Effets textuels. 6. Vraisemblance. 7. Technique narrative. 8. Personnages. 9. Dialogue. 10. Cadres. 11. Style. 12. Expérience. 13. Registre linguistique. » Il était difficile de faire plus simple ! Pour une certaine avant-garde, c’est la langue qui fait le partage entre fable et littérature. Ce qui, d’une certaine manière, est vrai, seule la langue fait la différence entre l’histoire d’un accident de voiture raconté à sa voisine chez le boucher (il y a l’espace, le temps, les personnages et la situation) et sa traduction littéraire. Mais c’est oublier que la littérature peut naître de la manipulation du temps (Le Désert des Tartares de Buzzati), de l’espace (L’Invention de Morel de Bioy Casares), des personnages (William Wilson de Poe) ou des situations (les nouvelles de Borges). Donc si on ne sait pas ce qu’est la littérature, on sait en revanche ce qu’elle n’est pas. Et tel est le néant dans lequel s’engouffre le traducteur, par exemple qu’est-ce qui fait du roman d’Alan Pauls, Le Passé, un texte littéraire ? En soi, si on le regarde de près, ni le temps ni l’espace ni la situation ni les personnages ni la langue. La langue d’Alan Pauls, appelée au secours dans une telle indécision, n’est d’aucune aide. Elle s’écoule comme elle est, précise, concrète, sans rien donner à mordre. Mais une lecture urgente comme celle que j’ai faite lorsque j’ai découvert le texte et l’ai lu d’une traite m’a révélé autre chose : le rythme. C’est par là que le texte accède (pas seulement mais surtout) à la plus haute littérature. Dans En lisant, en écrivant, Julien Gracq fait sans cesse la démonstration de ce qu’il était, c’est-à-dire le plus grand critique de son temps. Il écrit à propos de Stendhal, de Balzac, de Flaubert et de Zola : « Il y a pour chaque époque de l’art un rythme intime, aussi naturel, aussi spontané chez elle que peut l’être le rythme de la respiration, et qui, beaucoup plus profondément que son pittoresque extérieur, plus profondément même que les images-clés qui la hantent, la met en prise sur l’être et réellement la fait exister : c’est à ce rythme seulement que le monde pour elle se met à danser en mesure, c’est à cette allure seule qu’elle capte et traduit la vie, tout comme l’aiguille du gramophone ne peut lire un disque qu’à une certaine vitesse réglée et fixe ». Gracq m’a donné la clé de la traduction d’El Pasado d’Alan Pauls, ce n’était ni la passion ni la drogue ni la pathologie, c’était la bonne « vitesse » qu’il fallait trouver. Dès lors, la traduction du roman de Pauls est devenue un jeu d’enfant et je l’ai traduit en proie à une idée fixe : en quête du bon tempo. Paradoxalement, la référence à Proust présente dans tout le texte m’a freiné. Le phrasé de Pauls ne rappelle Proust que sur un point (non négligeable certes) : son architecture. Chaque phrase de Proust faite d’incises, de subordinations, d’échappées, de replis, de retours met en abyme cette cathédrale qu’est la Recherche. Sans doute, outre l’introspection, est-ce ce qui rapproche le plus Pauls de Proust : il se situe comme lui au-delà de l’innocence du roman, disons de la place du narrateur qui n’avait pas encore été pensée avant Flaubert comme l’a montré Vargas Llosa à propos des Misérables de Victor Hugo. Mais la téléologie de la phrase de Pauls est aux antipodes de la phrase proustienne : Proust fait volontairement du sur-place (il s’agit d’une anamnèse et le temps dit la vérité de l’être). La téléologie de la phrase de Pauls est à l’opposé : les mots sont toujours happés par un futur que rien ne préfigure (sauf si on fait une lecture psychanalytique du texte, ce qui n’est pas interdit). La phrase de Pauls est toujours propulsée vers un avant, elle a beau s’enrouler en volutes sur elle-même comme la phrase de Proust, elle imprime tout de même une accélération inouïe au récit. Cette vitesse vertigineuse a marqué tout le processus de la publication du Passé en France et l’a en quelque sorte absorbé. J’ai lu le livre en quelques jours (il fallait un avis urgent, d’autres éditeurs s’étant manifesté) et je l’ai traduit dans une sorte d’état second qui fait que le récit du processus de traduction est totalement reconstitué, il ne correspond qu’à mon sentiment actuel dans la mesure où je ne sais plus très bien ce qui s’est passé pendant mon travail. Je n’ai contacté Alan Pauls qu’après avoir remis ma copie pour élucider quelques détails techniques. Il m’a fait part de son étonnement car il ne savait pas si la traduction était en cours et a évoqué de son point de vue la démarche du traducteur : j’avais dû haïr le livre après l’avoir adoré. J’ignore si Le Passé est une traduction d’El Pasado. Je dirais que ouii, compte tenu de tous les garde-fous que j’ai évoqués. On ne m’a signalé ni faux-sens ni contresens encore que… Mais j’aurais souhaité que la traduction vive sa propre vie, qu’elle illustre ce que Julien Gracq dit du roman : « Que le roman soit création parasitaire, qu’il naisse et se nourrisse exclusivement du vivant ne change rien à l’autonomie de sa chimie spécifique, ni à son efficacité : les orchidées sont les épiphytes ». La citation de Gracq me ramène immédiatement sur terre après m’avoir fait un instant rêver : la traduction ne se nourrit pas de la vie mais d’un texte écrit, ce qui ne veut pas dire qu’elle et le texte initial soient morts, mais c’est tout de même ce dernier qui est allé chercher la vie. Le chapitre 13 de la première partie porte précisément sur la traduction, l’un des métiers exercés par Rímini, qui est présentée comme une servitude volontaire et le traducteur jouit moins de ses chaînes qu’il n’est victime dans sa solitude d’une addiction à la traduction qui s’accompagne de deux autres addictions qui sont peut-être des métaphores de la première : la masturbation et la cocaïne, à moins que ce ne soit le contraire. Peu importe. Les symptômes de ces addictions sont méticuleusement décrits mais rien n’est dit de leur origine, du pourquoi du corps « malade » du traducteur. Alan Pauls m’a un jour surpris lorsqu’il m’a dit à brûle-pourpoint, peut-être par boutade, qu’il ne s’intéressait qu’aux gens malades. Je me suis en vain cherché une maladie pour essayer de l’intéresser, mais encore une fois, tout allait trop vite pour le temps long de la maladie. Il n’est guère fréquent de lire (a fortiori de traduire) un texte qui mette le traducteur en abyme. Même s’il s’agit d’un traducteur de fiction (dans tous les sens de l’expression), c’est le traducteur réel que le chapitre interpelle à travers une triple expérience limite : la traduction forcenée, la masturbation frénétique, la consommation compulsive de lignes de cocaïne (Ah, encore des lignes). Le texte pointe le solipsisme du traducteur et produit en même temps un phénomène de surnuméraire : il y a un auteur canonique (Apollinaire), un premier traducteur, un narrateur, un auteur auquel s’ajoute un second traducteur dans le processus de traduction. Apparaissent entre eux effets spéculaires, identification, fusion, rejet, autrement dit toute la vie d’une petite société lovée sur elle-même, entraînée dans un maelström dont le premier traducteur réchappera de justesse. Dans ce vertige, on ne sait qui est en tête dans la descente, qui tire les ficelles, qui manipule ? Sans doute ni l’auteur canonique ni le second traducteur, mais à coup sûr soit le premier traducteur soit le narrateur soit l’auteur. Le texte pose donc le problème de la position du traducteur. En mettant en scène Rímini traducteur, le chapitre 13 met en abyme le traducteur qui est en train de traduire Le Passé et il se met lui-même en abyme à travers le texte que Rímini traduit : les Onze Mille Verges, un roman pornographique d’Apollinaire qui est, en fait, une parodie. Il fallait donc repérer les divers niveaux de langue et voir à quoi ils correspondaient. Micción, prepucio, verga, « miction », « prépuce », « verge » sont des termes cliniques, techniques qui renvoient à la scène décrite alors que bolsa de los huevos, mear, pija, « bourse des couilles », « pisser », « bite » renvoient au texte pornographique. Un exemple de ce jeu de la langue, p. 122 : « Il allait aux toilettes et, debout devant la cuvette, position choisie par commodité, pour ne pas avoir ensuite à s’occuper de nettoyer le sperme, et aussi à cause de la parenté qu’il percevait entre le sperme et d’autres excroissances humaines, il s’appuyait contre le mur, s’acharnait avec sa bite, avec ce poisson inerte pour lequel il aurait tout donné pour l’appeler bite et, au bout d’un moment, essoufflé, il retournait à son bureau, regardait de nouveau l’heure, et dégotait dans la bibliothèque une édition de poche des Onze Mille Verges, précisément l’un des rares souvenirs * qu’il avait gardés de son passage à l’agence de publicité où, outre travailler à des campagnes qui ne voyaient jamais le jour, rédiger des scénarios jamais filmés et créer, sur la demande du directeur, des produits imaginaires destinés à satisfaire des besoins imaginaires, il avait commencé à traduire quelques classiques de la littérature pornographiques, dont Les Onze Mille Verges, pour une collection que le pionnier dans l’utilisation des chaussures de bateau avait l’intention de vendre par lots de trois, enveloppés dans des sachets. » Les différentes entrées du texte (passé, présent, interdit, pornographie, humour) s’interpénètrent sans détruire l’équilibre fragile de la phrase qu’il faut préserver pour maintenir le tempo de l’œuvre. À ce titre, le segment « l’agence de publicité où, outre travailler à des campagnes » est à coup sûr une faiblesse. Traduire, c’est interpréter, toujours interpréter, se lancer dans une interprétation interminable, inépuisable à laquelle il faut, un jour, mettre arbitrairement un terme en attendant peut-être une retraduction qui sera une nouvelle interprétation (le texte infini de Borges). Ce qu’a fort bien compris la philosophie, par exemple Heidegger : « Toute traduction est en elle-même une interprétation. Elle porte dans son être, sans leur donner voix, tous les fondements, les ouvertures et les niveaux de l’interprétation qui se sont trouvés à son origine. Et l’interprétation n’est, à son tour, que l’accomplissement de la traduction qui encore se tait (…). Conformément à leur essence, l’interprétation et la traduction ne sont qu’une et même chose. » Communication prononcée à l’École Normale Supérieure le 19 mai 2008 à l’occasion de la journée d’étude : « Alan Pauls, un écrivain d’ailleurs ». |
||||||||||
|
|||||||||||
| www.enriquevilamatas.com | |||||||||||